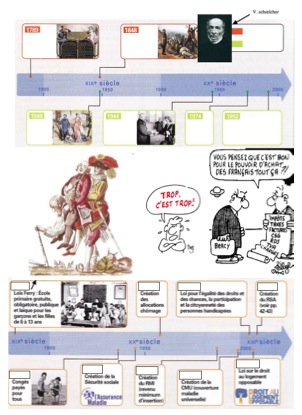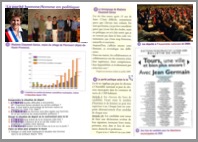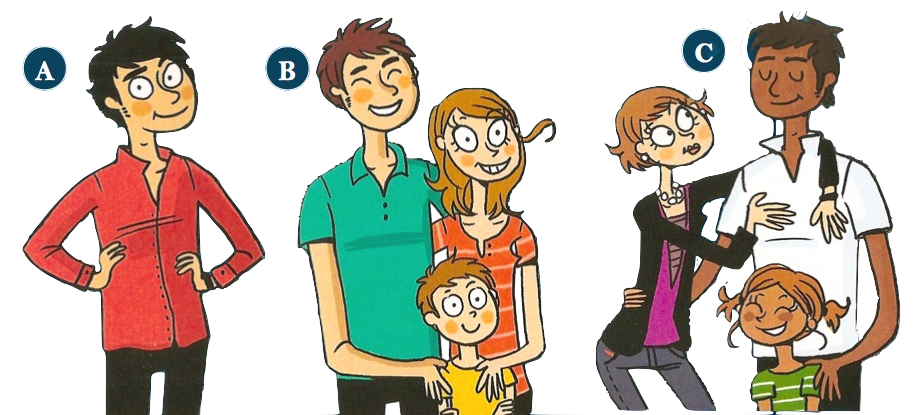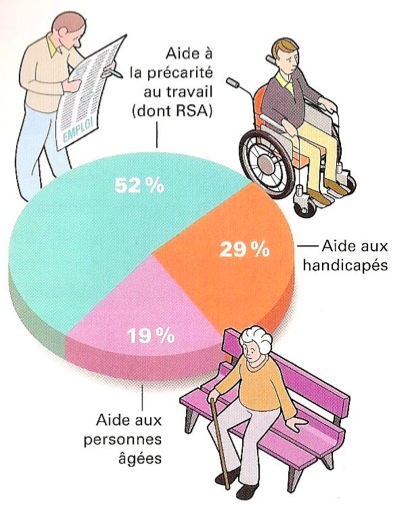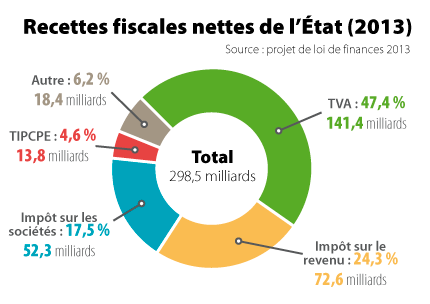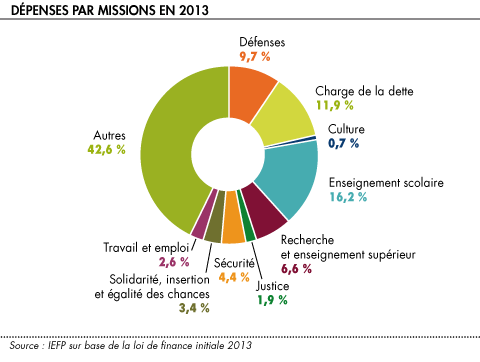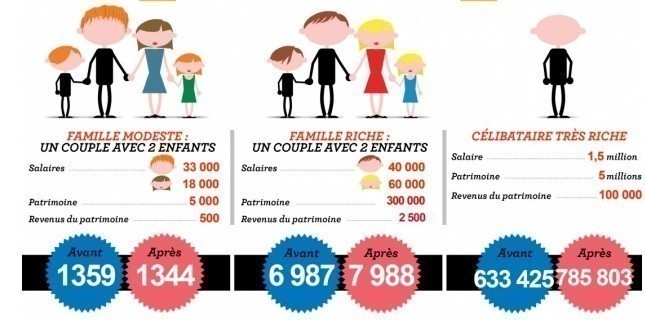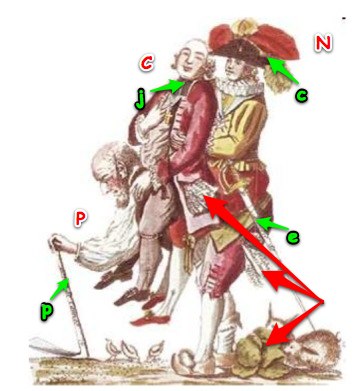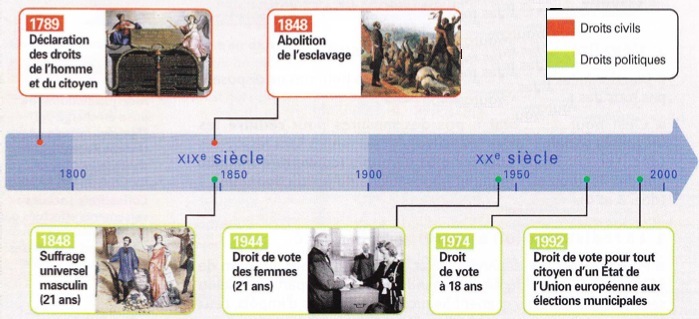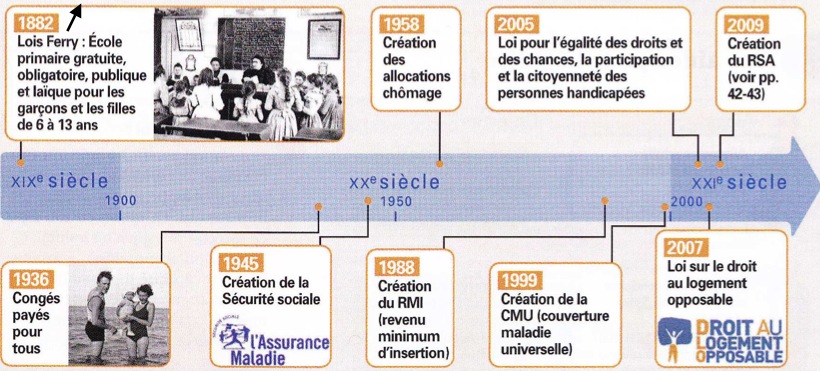L'égalité un principe républicain
1• Une conquête
progressive
Étude d'une
gravure antèrieure à la Révolution française
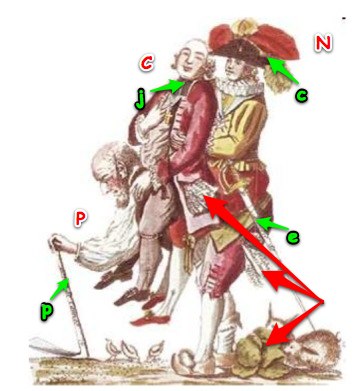
|
Cette gravure
présente la société des trois ordres:
C
1er ordre
: le clergé
(prêtres, moines, évêques…)
il porte un jabot : j
Le clergé ne paye
pas l'impôt, il possède les terres
|
P
R
I
V
I
L
É
G
I
É
S
|
|
N
2eme ordre
: la noblesse
(duc, comte, marquis…)
il porte une épée : e et un chapeau : c
La noblesse ne
paye pas l'impôt, elle possède les terres |
|
C
3eme ordre
: le tiers état
(paysans, bourgeois, artisans, domestiques…)
il tient une pioche j c'est lui qui
travaille (et supporte les autres)
Le tiers état paye de
nombreuses taxes et doit faire les corvées (listes qui
sortent des poches de la noblesse et du clergé)
Les animaux qu'il
n'a pas le droit de chasser ravagent ses récoltes.
|
|
L'image est une carricature : éxagération qui montre que la
société d'Ancien Régime est injuste à cause des inégalités.
D'autre sociétés
inégalitaires : Grecs ou Romains de l'Antiquité
Esclaves
Aucun droits
travail forcé
|
Femmes
étranger (métèques)
Des droits civils
|
Citoyen
droits politiques
possèdent la terre
|

|
|
 |
trés défavorisés —>
|
injustices
et inégalités
|
<— trés favorisés |
1.1• Les étapes
de l’égalité politique
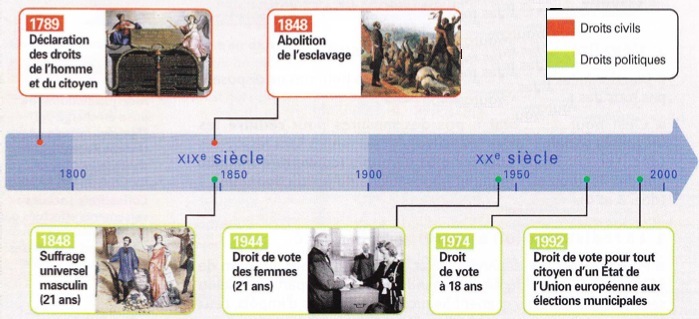
Avant 1789, la société française était inégalitaire,
fondée sur la division en 3 ordres (noblesse, clergé et
tiers-état) qui avaient des droits et devoirs différents.
Progressivement à partir de la Révolution française (1789),
les droits politiques favorisant l’égalité
sont mis en place : abolition de l’esclavage (1848) et suffrage
universel masculin (1848), droit de vote des femmes
(1944) et droit de vote pour les citoyens de l'Union Européenne aux
élections municipales (1992).
1.2• Les
étapes de l’égalité sociale
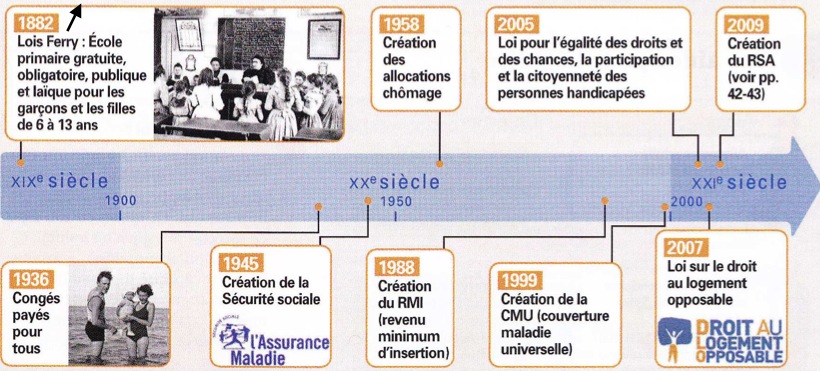
Des droits sociaux ont aussi progressivement été affirmés :
le droit à l’éducation gratuite pour tous, garçons et filles,
grâce à Jules ferry en 1882, le droit aux congés payés en
1936 ou encore le droit à la protection sociale avec
l’instauration de la Sécurité Sociale en 1945.
2• L'égalité
devant l'impôt.
L’impôt sur le revenu est un prélèvement obligatoire d’argent
sur les revenus des travailleurs pour subvenir aux dépenses
d’intérêt général de l’État. Son instauration suscita beaucoup
de débats, mais il fut mis en place en 1914 pendant la Première
Guerre Mondiale pour moderniser le système fiscal de l'État et
ainsi faire face aux dépenses engendrées par l'effort de guerre.
Pourtant, grâce aux impôts et en particulier l’impôt sur le
revenu, l’État finance des services publics (ensemble des
services rendus à la population par l’État et les collectivités
territoriales), accessibles à tous, quel que soit le niveau de
richesse : l’éducation, la justice, les hôpitaux... Sans
l’impôt, pas de dépenses publiques dans l’intérêt de tous.
L’impôt sur le revenu est progressif : plus les revenus
sont élevés et plus il est important. Mais le niveau de l’impôt
dépend aussi du nombre de part de chaque foyer (nombre d’adultes
et d’enfants) : plus le nombre de parts est important, plus
l’impôt diminue. Par sa progressivité, l’impôt sur le revenu
permet de corriger les inégalités de revenu, c’est une
contribution solidaire. Pourtant, seule une petite majorité de
contribuables (16 millions sur 33) acquitte cet impôt. Et
certains s’installent à l’étranger pour payer moins.
2bis •
L'égalité devant la protection sociale
Toute personne qui travaille est obligatoirement inscrite à la
Sécurité Sociale, elle est un « assuré social ».
Le taux de remboursement varie de 35% (médicaments vignette
bleue) à 100% (médicaments irremplaçables). La visite chez le
médecin est prise en charge à 70%.
La Sécurité Sociale a été créée en 1945 au sortir de la
Seconde Guerre Mondiale. C’est un système de protection sociale
qui rembourse une partie des frais en cas de maladie ou
d’accident du travail, verse une pension aux retraités et des
allocations aux familles modestes. Ainsi toute personne qui
travaille est automatiquement inscrite à la Sécurité Sociale
et devient un « assuré social ».
La Sécurité Sociale fonctionne grâce aux cotisations
versées par les employeurs et les salariés à l’URSSAF. Il
s’agit d’un système de solidarité puisque les salariés
cotisent pour l’ensemble de la communauté sans savoir s’ils
seront un jour malades ou parents et car les actifs (salariés
cotisants) cotisent pour les passifs (retraités) : on parle de
solidarité intergénérationnelle. Cependant, des problèmes de
déficit mettent la Sécurité Sociale en danger.
3• L'égalité au
collège
Étude de documents
Document 1 : photographie
Une salle informatique
dans un collège. Les tables sont circulaires,
les élèves se font face et les ordinateurs sont connectés
à internet. Un professeur est présent au fond de la salle.
|
Document 2 : photographie
Un élève handicapé
accueilli dans un collège.
L'élève est dans un fauteuil roulant, une sorte de casque
capte ses mouvements, devant lui un pupitre et un jeune
adulte l'aide.
|
Document
3 : texte
L'accompagnement éducatif
dans un collège de Marseille
Jeudi, 18 heures :
toutes les salles de classe du Ier étage du
collège Jules-Ferry de Marseille sont éclairées. «
L'école après l'école », concerne ici 141 élèves.
Certains, comme Elyes, sont présents tous les soirs en
soutien scolaire : « ça m'apporte de bonnes notes, j'ai
eu un 13 et un 15,5 en français et maintenant, je révise
le brevet blanc ». Pour Nicolas, le professeur de
français qui encadre cette séance de soutien scolaire, «
c'est comme des cours particuliers ».
Pour Djamel, le professeur d'anglais, « certains élèves
n'ont pas d'habitudes de travail et on leur apprend ces
habitudes ; d'autres sont déjà plus autonomes mais
trouvent ici un endroit au calme ».
D'après le site Internet
du rectorat de Marseille. 2009.
|
Questions
Doc. 1 • Que font les élèves dans cette salle ? Pourquoi cela
permet-il de maintenir une égalité entre tous les collégiens ?
Doc. 2 • Comment la scolarisation de cet élève handicapé avec
les autres élèves de sa classe est-elle rendue possible ?
Doc. 3 • Quels sont les avantages du système d'accompagnement
éducatif organisé après les cours ?
• Quelles sont, dans votre collège, les actions qui permettent
de maintenir l'égalité entre les élèves ?
• Comment pourriez-vous, en tant qu'élève, aider les élèves en
difficulté pour augmenter leurs chances de réussir ?
Débattre
• As-tu le sentiment que tu bénéficie
s du droit à l'égalité des
chances au collège ?
Les élèves sont
connectés à internet, l'accès à internet au collège permet de
maintenir une égalité entre les élèves, car certains n'ont pas
la possibilité de se connecter à la maison.
L'aide d'un A.V.S.
(assistant de vie scolaire) et un matériel adapté :
fauteuil roulant, ordinateur, lutrin, permet à un élève
lourdement handicapé de suivre une scolarité avec les autres
élèves.
L'accompagnement
éducatif donne aux élèves la possibilité de travailler dans le
calme, d'être aidés personnellement, d'avoir des habitudes de
travail : méthode et autonomie.
Au collège, grâce
au C.D.I. les élèves peuvent trouver la documentation pour une
recherche, ils peuvent aussi se connecter à internet et lire
de nombreuses revues. Le F.S.E. (foyer socio-éducatif), la
chorale, les clubs et l'UNSS offrent des loisirs accessibles à
tous.
L'assistante
sociale peut utiliser le « fond social collégien »
pour venir en aide financièrement aux familles des élèves.
Il
y a égalité des chances car
|
|
Il
n'y a pas égalité des chances car
|
Tous
peuvent avoir accès internet
Tous peuvent être aidés
L'aide concerne particulièrement ceux qui ont des
difficultés.
Les bourses sont versées à ceux qui sont moins riches.
La scolarité est obligatoire.
|
|
Certains
ont moins de capacités intellectuelles.
Des élèves n'ont pas le soutien de leur famille.
Des élèves ont des handicaps.
|
Pour approfondir, consulter le site de l'Éducation nationale :
http://www.education.gouv.fr/cid5677/accompagnement-educatif.html
Le site propose des liens sur les actions d'accompagnement
éducatif mises en œuvre en France.
4• L'égalité entre garçons et filles
Étude de documents.
Document
1 : texte
Des inégalités
entre garçons et filles a l'école
Dès l'école primaire,
les filles obtiennent de meilleurs résultats scolaires
que les garçons et elles redoublent moins. Elles ont de
meilleures évaluations en CE2 en français mais, dès ce
très jeune âge, elles ont de moins bonnes évaluations en
mathématiques. En 2005, 82,3 % des filles ont obtenu le
brevet et seulement 75,6 % des garçons. Elles
réussissent le baccalauréat à près de 82 % contre 77,7 %
de garçons. (Quelle que soit leur réussite scolaire, les
filles vont moins que les garçons en 1e scientifique.
Elles s'engagent très rarement dans les sections
industrielles, car elles se voient moins que les garçons
dans les métiers industriels. L'insertion des filles
dans la vie active est plus difficile ensuite à cause de
ces choix de départ. Ce constat met en évidence la
persistance des préjugés et des stéréotypes dans la
société et sans doute aussi à l'école.
D'après un rapport du
ministère de l'Education nationale, juillet 2009.
préjugé (un) : opinion adoptée sans avoir
réellement réfléchi.
stéréotype (un) : représentation simplifiée et
déformée d'une réalité.
|
Document
2 : texte
Le témoignage de Julia
Quand j'étais petite, je
voulais être médecin. Puis j'ai préféré les maths et la
physique. Mais j'aimais aussi le français et l'histoire.
Cela m'a aidé pour réussir, car les garçons étaient
souvent des cracks, mais seulement en maths. Après le
bac, dans ma prépa scientifique, nous étions 10 filles
pour 50 élèves. J'ai réussi à avoir l'école
polytechnique. Pourtant, cette année, il n'y a que 54
filles à avoir eu le concours d'entrée pour 400 places.
C'est très peu ! Et c'est pour cela qu'il faut que
beaucoup plus de filles se présentent au concours des
grandes écoles d'ingénieurs. On a toutes des chances de
réussir.
D'après un entretien de
juillet 2009.
|
Document
3 : graphique.
Filles :
Français CE2 73%
Math CE2 69%
Français 6e 60%
Math 6e 62%
Garçons :
Français CE2 68%
Math CE2 71%
Français 6e 54%
Math 6e 66%
Education Nationale 2008
|
Document
4 : photographie
Prix de la vocation scientifique
et technique des filles

|
Document
5 : photographie
fais une recherche à partir des mots «défilé» et
«polytechnique»

École polythechnique : grande école
militaire qui forme des ingénieurs de haut niveau.
Elle est mixte depuis 1972.
|
Document
6 : texte
Corriger les inégalités
entre filles et garçons
À cette date, la proportion de filles dans ces classes
doit atteindre 44,6 %. C'est à l'école, et dès le plus
jeune âge, que s'apprend l'égalité entre les sexes.
L'apprentissage de l'égalité entre les garçons et les
filles est une condition nécessaire pour que,
progressivement, les stéréotypes s'estompent et d'autres
modèles de comportement se construisent. Basée sur le
respect de l'autre sexe, cette éducation à l'égalité fait
partie de l'éducation civique. Les établissements
scolaires sont invités à développer toutes les actions de
sensibilisation et de formation qui peuvent apprendre le
respect de l'autre.
D'après Filles et
garçons sur le chemin de l'égalité. ministère de
l'Education nationale, juillet 2009.
|
Questions
1• Doc. 1 et 3 • Qui, des filles ou des garçons, obtiennent de
meilleurs résultats à l'école ? En quelle matière les garçons
réussissent mieux ?
2•Doc. 1 • D'après le texte, pourquoi les filles vont-elles
moins dans la série scientifique ou professionnelle ?
Quel problème cela peut-il leur poser par la suite ?
3. Doc. 2 et 5 • Quelle voie a choisie Julia pour
ses études ?
Y a-t-il un nombre égal de filles et de garçons
dans l'école
où elle est entrée ?
4• Doc. 2 • Selon Julia, que devraient faire les filles qui
poursuivent des études ?
5• Doc. 4 et 6 • Que propose le ministère de l'Éducation
nationale pour qu'il y ait plus d'égalité entre les filles et
les garçons à l'école ?
Pourquoi les
garçons et les filles ne sont-ils pas égaux à l'école ?
Comment y remédier ?
Les filles
réussissent mieux que les garçons dans leurs études.
Cependant, elles sont encore trop peu nombreuses à choisir de
faire des études scientifiques et techniques, qui offrent
pourtant le plus de débouchés sur le marché du travail. Les
différences d'orientation entre filles et garçons ne sont pas
dues qu'à des choix, mais aussi à des inégalités et à des
préjugés.
Le ministère de l'Éducation nationale encourage les filles à
faire des études scientifiques.
- préjugé (un)
- opinion adoptée sans avoir réellement réfléchi.
- stéréotype (un)
- représentation simplifiée et déformée d'une réalité.
5•La parité homme/femme en politique
Document 1 : photographie
Madame Chaumont-Gorius.
maire du village de Pierrevert
(Alpes-de-Haute-Provence).
À gauche
avec l'écharpe tricolore et à droite avec des conseillers
municipaux.
|
Document
2 : Texte
Le témoignage de Madame
Chaumont-Gorius.
J'ai été élue maire
après 15 ans de lutte. C'était difficile, notamment
parce que j'élevais mes enfants. En tant que femme, j'ai
pu être considérée parce que j'avais fait des études,
mais en politique, on m'a fait sentir que je ne rentrais
pas dans le bon code vestimentaire, que j'étais trop
féminine, naturelle et souriante. Aujourd'hui, j'affiche
encore cette féminité, je revendique ma différence.
Dans ma mairie, les collaborateurs et collaboratrices
ont des missions selon leur expérience, leurs
compétences, leur disponibilité, et évidemment pas selon
leur sexe !
D'après un entretien réalisé en juillet 2009.
|
Document 3 : Graphique
L'évolution du
nombre de femmes conseillères municipales, maires et
députées depuis 1945
Le graphique présente le pourcentage de femmes
maires, de femmes députées
et de femmes conseillères municipales
en France
de 1945 à 2008
|
Document
4 : texte
La parité politique selon
la loi
La loi ne s'applique pas pour les élections à l'Assemblée
nationale ni pour les élections municipales dans les
communes de moins de 3 500 habitants.
Article 3. Sur
chacune des listes de candidats, l'écart entre le nombre
d'hommes et de femmes ne peut être supérieur à un. Chaque
liste est composée alternativement d'un candidat de chaque
sexe.
Article 14. Les
candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de
leur signature, énonçant leurs noms, prénoms, sexe, date
et lieu de naissance, domicile et profession.
D'après la loi n° 2000-493
du 6 juin 2000.
|
Document 5 : photographie
Les députés à l'Assemblée
nationale en 2009.
Sur cette photographie d'une partie de l'Assemblée
nationale, on ne distingue pas de femmes. |
Document 6 : photographie
Une liste de candidats
pour les élections municipales de 2008.
ÉLECTIONS MUNICIPALES 9 ET 16 MARS 2008 Bulletin de vote
de la liste de Gauche et du centre.
Les noms de femmes et d'hommes alternent sur la liste, il
y a autant d'hommes que de femmes.
|
Questions
1.• (doc. 1 et 2) Quelles difficultés a rencontrées M™
Chaumont-Gorius pendant sa carrière politique ?
2• (doc. 3) Quel était le pourcentage de femmes maires ou
députées en 1945 ? En 1989 ?
3• (doc. 1, 2 et 3) Les femmes sont-elles égales aux hommes en
ce qui concerne les responsabilités politiques ?
4.• (doc. 4 et 6) Quel article de la loi respecte cette liste ?
5.• (doc. 3 et 4) L'influence de la loi est-elle visible sur le
graphique ? Justifiez votre réponse.
6..• (doc. 3, 4 et 5) Quelles sont les limites de la loi sur la
parité ?
7. • Rédige un petit texte expliquant la situation des
femmes
dans la vie politique depuis 1945.
Les femmes ont obtenu le droit de vote en 1944, mais elles
n'accèdent que très lentement aux responsabilités politiques
(maire, député, ministre) durant la seconde moitié du XXe
siècle. Pour combattre cette situation, une loi sur la parité
homme/femme en politique a été votée en 2000.