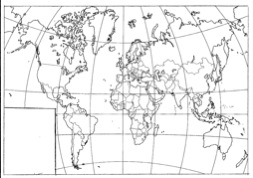Des
inégalités devant la santé
1• Études de cas : les soins
dentaires
Comparaison de situation
4 extraits vidéo pour comparer l'accès au soins dentaires
— Dentiste de rue en Inde
— Jeune dentiste au Canada
— Extraction d'une dent dans une campagne Ukrainienne
— Touristes soignés dans un hopital chinois
Pour chaque extrait :
— Localisation : État, continent, milieu (rural/urbain/isolé) ,
lieu précis (cabinet, hopital, rue)
— Poulation concernée (personnes favorisés, défavorisées, classe
moyenne)
— Expérience ou formation du praticien
— Matériel et techniques utilisées (fauteuil, outils,
stérilisation, anesthésie)
Cette présentation est complétée par les documents 2 et 3 de la
page 201 du livre.
Les indicateurs de santé pour les 6 pays concernés par les
documents
Voir sur le site de l'OMS : http://www.hcsp.fr/docspdf/adsp/adsp-08/ad080608.pdf
Statistiques sur le site de l'OMS : http://www.who.int/workforcealliance/knowledge/data/fr/index.html
Rapport complet sur le site de l'OMS :http://www.who.int/whosis/whostat/EN_WHS10_Full.pdf
Pour trouver l'espérance de vie à la naissance voir page 47 du
rapport.
Accès à l'eau potable et accès aux soins page 100.
Après avoir rempli le tableau on fait une synthèse.
| Localisation |
|
Poulation concernée |
Praticien |
Matériel et techniques |
esp de
vie
|
accès
eau p
|
accès
soins
|
Inde
|
 |
Défavorisée urbaine |
Homme expérimenté |
Dans la rue
Réutilisation de la seringue anasthésie.
pas de fauteuil, outils dentaires. |
64 ans
|
88%
|
31%
|
Canada
|

|
Favorisé pays développé |
Formation universiataire
Assisté d'une hygièniste |
Ordinateur, gants,
masques, fauteuil électrique, fraise (roulette) moderne,
blouses. |
81 ans
|
97%
|
90%
|
Ukraine
|
 |
Joyeux compères
|
Homme adroit sans
qualification |
Pince universelle et
alcool (anesthésiant et désinfectant |
68 ans
|
97%
|
90%
|
Chine
urbaine
|

|
Touristes de passage
(surpris par le faible prix des soins). |
Chirurgien dentiste et assistant. |
masques, fauteuil
électrique, fraise (roulette), blouses |
74ans
|
98%
|
58%
|
Chine
rurale
|
Voir document 2
page 210 du livre
|
Modeste : paysans?
|
Homme expérimenté |
Une fraise, le travail est
fait à l'extérieur. |
74ans
|
82%
|
52%
|
| Royaume-Uni |
Voir document 3
page 210 du livre |
Aisée, accès au soins
facile |
Formation universitaire
Assisté d'une personne |
Ordinateur, gants,
masques, fauteuil électrique, fraise (roulette) moderne,
blouses |
80ans
|
100%
|
100%
|
(p200) A
l'échelle mondiale, les indicateurs de santé (espérance de vie,
taux de mortalité infantile, accès aux soins et à l'eau potable)
n 'ont jamais été aussi bon. Toutefois, cette amélioration
globale cache des inégalités devant la santé très importantes, à
toutes les échelles.
2• Une pandémie
: VIH
Question 1 à 4 page 203 du livre
Vidéo 1 : Journal de 20h - A2 - 2006Dans le monde :
39 millions de personnes séropositives
24 millions en Afrique subsaharienne.
130 000 en France et 7000 de plus chaque année
2,7 millions de cas de plus dans le monde chaque année.
Vidéo 2 : site internet
2.1• Un virus particulier
VIH : virus
d'immunodéficience humaine
SIDA : syndrome
d'immunodéficience acquise
Transmission :
surtout par le sang (seringues ou rapports sexuels).
Séropositif :
porteur du virus.
Il n'existe pas
de vaccin.
2.2• Limiter la propagation du VIH
et ses effets
rapports sexuels
protégés
dépistage
traitement
post-exposition
Limiter l'apparition du SIDA
Video : AfriqueSIDA.jpg
Association de
trois antiretroviraux qui inactivent le VIH
2.3• Intensifier la
recherche médicale
Dépistages plus
simples et moins couteux.
Limiter les
effets secondaires des ARV
Elaborer des
"candidats" vaccins
3• L'accès aux
médicaments
Vidéo 1 : Le
SIDA au Burundi
Coproduction Etat d'urgence Production et IRD avec France 5 et
TV monde.
— Carte et localisation du Burundi
— Témoignage d'une élève qui a découvert qu'elle avait le SIDA
lors d'un cours de science en sixième.
— La vie des malades dans le centre Thurio (repas, vie
quotidienne et témoignages)
— Interview de Jeanne Gapiya fondatrice de l'association ANSS
(Association nationale de soutien aux séropositifs et sidéens).
— La création et la vie de l'ANSS : la création d'un hôpital de
jour
— Témoignage des médecins : effets du traitement, dépistage,
difficultés d'obtenir des médicaments.
— Coût du traitement par rapport aux revenus des malades, la
prise en charge par la solidarité familiale et les associations
caritatives (AIDS).
— Médicaments et droits sur la propriété intellectuelle de l'OMC
(organisation mondiale du commerce). La protection des droits
exclusifs de fabrication pendant 20 ans.
— Explication de Philippe Pignarre auteur du livre « Le grand
secret de l'industrie pharmaceutique »
— Point de vue du Dr Bernard Pecoul, Directeur de la « Campagne
d'accès aux médicaments essentiels »
— Point de vue du Dr Jean-François Chambon secrétaire général
d'une fondation GlaxoSmithKline (laboratoire)
— Point de vue de German Velasquez économiste de l'OMS
(Organisation mondiale de la santé).
Les actions politiques, pour que les médicaments soient
accessibles aux pays en développement : commission européenne,
Seattle, Amsterdam, OMC et campagne présidentielle américaine de
2007.
— Interview de Harvey Bale directeur général de la fédération
internationale de l'industrie du médicament.
Aujourd'hui les malades peuvent être soignés avec des moyens
efficaces, les séropositifs des pays riches ont accès aux ARV,
mais seule une infime partie des Africains bénéficie de ce
dispositif et le SIDA a tué plus de 20 millions d'Africains, sur
42 millions de séropositifs en 2010, 30 millions vivaient en
Afrique.
Les ARV (médicaments Anti Rétro Viraux) qui stoppent les
effets du SIDA coûtent très cher, car ils sont protégés par des
brevets. Les pays africains n'ont pas le droit de les produire à
bas coût (pour un malade les soins coûtent 12 000 euros par
an).
L'accès au soins varie en fonction du niveau de développement
du Pays.
Vidéo 2 : Information en français de la CCTV :
télévision centrale chinoise
— Annonce de la baisse de 12 % du prix de 96 médicaments à
usage quotidien (soit presque la moitié) par la présentatrice
(chinoise).
— Interview d'habitants satisfait de la baisse de prix.
— Exemple des médicaments pour traiter les maladies
cardio-vasculaires en baisse.
— Rayonnages de pharmacies chinoises (qui ressemblent aux
pharmacies européennes)
— Les médicaments difficiles à trouver sont les seuls qui ont
augmenté.
— La nouvelle tarification est sans bénéfices pour les
pharmaciens.
En Chine l'État décide de baisser le prix des médicaments, les
médicaments sont fabriqués sous le contrôle de l'État.
L'accès aux soins peut dépendre des politiques mises en
place par les États.
Vidéo 3 : Reportage sur l'industrie pharmaceutique en
Inde : Antenne 2 le 21 juillet 2009
— progression de l'industrie pharmaceutique et des tests
cliniques en Inde.
— Présentation de Brijesh Régal fondateur de la clinique de test
« Apothecaries » en banlieue de Delhi.
— L'information et le recueil des consentements des « cobayes
humains »
— le tri des candidats payés par le laboratoire en fonction des
maladies.
— avec 1,3 milliard d'habitants , l'Inde permet de trouver de
nombreux malades pour les tests, même si la maladie n'est pas
courante (35 millions de diabétiques, 3 millions de cancéreux).
— Interview d'une femme qui a testé une pilule contraceptive et
qui a gardé de nombreuses séquelles : maux de tête,
vomissements. La femme a fait les tests pour gagner de l'argent
et n'a pas été informée des conséquences possibles.
— Malgré une législation qui correspond aux normes
internationales, l'Inde utilise la population pauvre et
analphabète pour des tests.
— Interview de Noor Jahen qui représente l'association des
femmes musulmanes indiennes et qui dénonce les cancers de
l'utérus et les maladies de la peau provoqués par les tests,
elle accuse les compagnies étrangères de profiter de la misère.
— Arnauld Miguet (envoyé spécial de France 2 à New Delhi) montre
les sac de médicaments que l'on trouve en vrac sur les marchés
en Inde, 400 tests humains sont en cours, l'industrie
pharmaceutique pèse 800 millions d'euros en Inde.
L'Inde est un pays producteur de médicaments, on y trouve de
nombreux malades prêts à tester les médicaments.
Vidéo 4 : Vaccination contre la grippe H1N1
au collège Émile Gallé (Nancy), reportage de France 3
— Des élèves disent ce qu'ils
savent sur la grippe devant des journalistes et des membres du
rectorat et de l'inspection académique.
— une infirmière examine les
autorisations signées par les parents et les carnets de santé.
— on voit les affiches avec
les consignes de sécurité : lavage des mains et port d'un
masque buccal.
— Interview de MM Clémens et
Bicoche de l'inspection d’académie (écrit avec une faute)
— entretien des futurs
vaccinés avec le médecin qui étudie l'enquête complétée par
les parents.
— Interview du principal du
collège : rythme de 7 à 8 vaccinations par heure.
— l'infirmière fait la piqure.
— Interview de deux
enseignantes qui s'étonnent de ne pas avoir été sollicitées
alors qu'elles s'estiment aussi exposées à la maladie. Elles
regrettent que la vaccination soit faite dans l'urgence, que
l'organisation soit lourde et que peu d'élèves se soient fait
vacciner.
Vaccination contre la grippe H1N1 dans un collège de France.
L'épidémie n'a pas eu lieu mais on a appliqué le principe de
précaution (ce qui peut coûter cher).
Vidéo 5 : Reportage vidéo de l'AFP (agence France
Presse) en Turquie
— Patiente grecque qui fait un examen de la cornée dans un
hôpital turc spécialisé dans les maladies des yeux. Stéfani
Balasi, infirmière, associe chirurgie et vacances en
famille : c'est du tourisme médical, conseillé par des amis qui
ont fait de même. En Turquie l'opération coûte 1000 euros alors
qu'en Grèce, elle coûte 2500 euros. Les techniques utilisées
sont très modernes : informatique et rayon laser. La main
d'œuvre coûte moins cher en Turquie, le groupe hospitalier
Dünyagöz est important, il a 10 hôpitaux et il peut ainsi
réduire les coûts.
— Gökhan Yugrucu manager des relations internationales des
hôpitaux Dünyagöz explique qu'avec 150 docteurs, il peut
négocier des prix d'achat de matériel très bas.
— le ministère de la Santé turque espère en un an doubler le
nombre de touristes médicaux (image de soins dentaires). Un
centre de soins dentaires turc accueille une Parisienne qui a
besoin d'implants, elle devra payer moins de 2200 euros au lieu
de 4600 euros.
— Interview de Mustafa Bese dentiste de la Ata Dental Clinique
qui reçoit des patients allemands, britanniques et français
(tout le monde a peur des dentistes) : le prix de l'intervention
en Turquie redonne le sourire aux patients.
Avec la mondialisation (les échanges de biens et de services
dans le monde), le tourisme médical se développe.
3.1• Recherche
pharmaceutique et poids des brevets
L'élaboration
d'un nouveau médicament est coûteuse, les tests qui précèdent la
mise en vente sont longs et doivent êtres effectués sur un
nombre important de personnes, pour des raisons économiques ils
peuvent être fait dans des pays à faible niveau de vie.
Les découvertes pharmaceutiques sont protégées par des brevets.
Dans certains cas, des personnes ne peuvent pas accéder aux
soins car le prix de vente est très supérieur au prix de
fabrication.
La recherche de médicaments se fait en fonction des marchés :
il peut être plus rentable de trouver un médicament de confort
pour les pays développés qu'un médicament de soin pour une
pandémie des pays du Sud
3.2• Politique
de santé
La politique de
santé mise en place par un Etat ou par une organisation peut
avoir une grande importance sur l'accès aux médicaments.
La Chine a décidé
de baisser le prix des médicaments (fixés par l'Etat).
Des pays
africains ont défini une liste de médicaments pour les
dispensaires.
En France les
médicaments vitaux sont entièrement remboursés.
La vaccination
permet de protéger une population face à une menace virale, elle
peut être obligatoire dans certains pays.
Les médicaments génériques sont des
médicaments dont la formule (le brevet) est tombée dans le
domaine public, il peuvent donc être produit par des
laboratoires qui n'en sont pas les inventeurs.
Généralement, ils sont moins chers.
DVD Fred et Jamy vous expliquent les génériques
3.3• Des remèdes
pires que le mal
Les médicaments
sont des substances chimiques souvent dangereuses, ils ne sont
commercialisés que lorsque l'on en connait tous les effets.
Document 2 page 204 et document 3 page 205.
Dans un certain
nombre de pays la vente des médicaments n'est pas contrôlée.
Le coûts des
soins pousse des habitants souvent illétrés à pratiquer
l'automédication.
Des commercants
peu scrupuleux ou ignorants n'hésitentent pas à vendre des
médicaments inapropriés.
4• Des
inégalités face aux soins.
Questions de la page 209
4.1• Des
améliorations dans le monde
A la fin du XXéme
siècle, l'espérance de vie à beaucoup augmenté, la mortalité
infantile a fortement baissé.
- Taux de mortalité infantile
- nombre de décès d'enfants de un ans pour 1000 naissances
vivantes de la même année.
4.2• Une fracture
sanitaire
Construction d'une carte
thématique à partir des trois cartes des pages 206 et 207.
Sur le planisphère, colorier en rouge les pays qui réunissent
ces trois critères:
— moins de dix médecins pour 10 000 habitants
— une mortalité infantile supérieure à 30 ‰
— une espérance de vie inférieure à 60 ans
colorier ensuite en vert les pays qui réunissent ces trois
autres critères :
— plus de vingt médecins pour 10 000 habitants
— une mortalité infantile inférieure à 30 ‰
— une espérance de vie supérieure à 70 ans
Les autres États sont à colorier en orange, compléter la
légende.
Indiquer deux États étudiés en sixième qui ont été coloriés en
rouge, et quatre pour les couleurs verte et orange.
Les contrastes
sont très importants entre les pays les moins avancés
(PMA) qui ne disposent pas d'infrastructures de santé
suffisantes (hopitaux, dispensaires, maternités, centre de
soins, cabinets médicaux ou infirmiers) et les pays développés
dans lesquels les frais de santé représentent une part
importante du produit national (la richesse produite par le
pays)
Dans les pays émergents on constate d'énormes différences entre
les métropoles bien équipées (hopitaux de pointe) et les zones
rurales dotées de rares dispensaires.
La pauvreté est à l'origine de sousnutrition (famines), de
pandémie (VIH, choléra, paludisme, tripanosomiase) dans les PE
et PMA et de l'exclusion dans les pays développés dans lesquels
on rencontre aussi des cas de malnutrition par surnutrition
(obésité).
4.3• Des
organisations de régulation
Sur les huit
objectifs du millénaire fixés par l'ONU (Organisation des
Nations Unies) en 2000, quatre concernent directement la
santé :
Objectif 1 :
réduire l'extrême pauvreté et la faim
Objectif 4 :
réduire la mortalité infantile
Objectif 5 :
améliorer la santé maternelle
Objectif 6 :
combattre le VIH/SIDA, le paludisme et les autres maladies
L'OMS
(Organisation Mondiale pour la Santé) est chargée de veiller à
la réalisation de ces objectifs grace à la mise en place de
programmes de santé pour les PMA.
De nombreuses ONG
(organisation non gouvernepmentales) contribuent à l'aide
médicale : Croix rouge, Médecins Sans Frontières (MSF), Santé
Sud…
- c
- p
RESSOURCES
Paludisme et développement
durable en Afrique
Paris
DVD Fred et Jamy : les génériques
Le dossier comporte dans ses rubriques :
- Information scientifique : Les flux internationaux de
personnel de santé, une illustration des inégalités de
développement / Mobilités et accès aux soins des migrants en
France / Lieux d’émergence et territoires de diffusion de la
fièvre hémorragique à virus Ebola au Gabon et en République
du Congo.
- Corpus documentaire : Espaces et territoires du paludisme
/ L'organisation territoriale et la planification sanitaire
en France (principales évolutions législatives et
réglementaires du système de santé en France ; territoires
de santé et planification sanitaire ; nouveaux territoires
de santé auvergnats ; diagnostic et définition des
territoires de santé, l'exemple de la région Rhône-Alpes).
- Géographie vivante : Expertise, gestion du risque et
santé publique.
- Un glossaire précise le vocabulaire employé, les notions
et les connaissances, il organise les renvois aux contenus
du dossier.
Des contributions supplémentaires viendront enrichir le
dossier dans les mois à venir. Un module de cartographie
interactive (géoclip) sera proposé prochainement.
Ce dossier a été initié et
coordonné par Virginie Chasles (université de Lyon, Jean
Moulin Lyon 3, Équipe Santé Individu Société) et il a
bénéficié des contributions de : Virginie Chasles, Clélia
Gasquet-Blanchard (département EPI-Biostat, Ehesp,
laboratoire Espace Santé et Territoires, université Paris
Ouest), Anne-Cécile Hoyez, (UMR 7301 Migrinter, université
de Poitiers), Clara Loïzzo (classes préparatoires aux
grandes écoles, lycée Masséna, Nice), Sylviane Tabarly (ENS
de Lyon / Dgesco)..
Pour accéder au dossier : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actus/index.htm