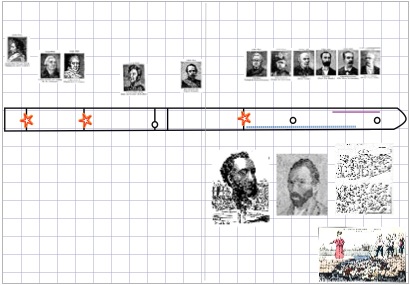L’ÉVOLUTION POLITIQUE DE LA FRANCE, 1815-1914
1• La recherche
d'un régime politique
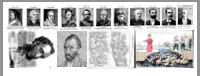 Frise
chronologique : Les régimes politiques de la France de
1810 à 1910.
Frise
chronologique : Les régimes politiques de la France de
1810 à 1910.
Rappels de ce qui a été vu en début d'année : présentation de la
succession des Bourbons (diaporama), évocation des évènements de
la Révolution française (fin de la monarchie absolue, monarchie
constitutionnelle, la république, le consulat et sa
transformation en monarchie impériale).
Construction d'un axe chronologique sur une double page (feuille
d'illustration fournie)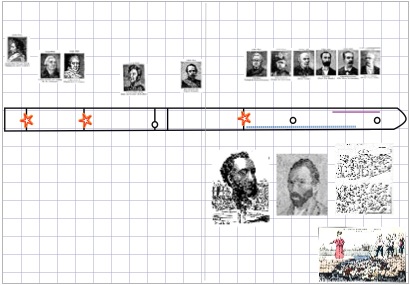
— 1er Empire (avant 1815) - illustration : Napoléon Ier
— 1815 défaite de Waterloo, Congrès de Vienne (étoile sur l'axe
= guerre ou insurrection)
— Restauration (de 1815 à 1830) - illustrations : Louis XVIII et
Charles X (frères de Louis XVI)
Les Cent jours et la première restauration qui les a précédés ne
figurent pas sur l'axe afin de simplifier la chronologie.
— 1830 insurection des "Trois Glorieuses" en juillet
— Monarchie de Juillet (1830-1848) monarchie constitutionnelle -
illustration : Louis Philippe 1er
— 1848 révolution de février : suffrage universel (masculin),
abolition de l'esclavage
— IIème République (1848-1851) - illustration : Louis
Napoléon Bonaparte 1er président de la République
— 2nd Empire (1852-1870) - illustration : Napoléon
III ( Louis Napoléon Bonaparte)
— 1870 Guerre franco-prussienne, Défaite de Sedan, Perte de
l'Alsace et de la Lorraine, Insurrection de la commune (1870).
—IIIème République (1871-1939) - illustrations : Adolphe Thiers,
Patrice de Mac Mahon, Jules Grévy, Sadi Carnot, Jean
Casimir-Perier, Félix Faure
— 1881-1882 Jules Ferry, les lois sur l'école gratuite, laïque
et obligatoire.
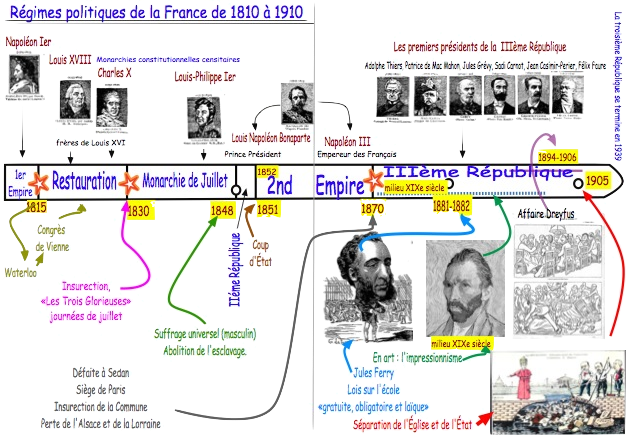
2• Un exemple de division politique sous la IIIe
République : l'affaire Dreyfus
Travail en salle informatique
L'AFFAIRE DREYFUS: exercices
Le travail à faire :
— Créer un document texte avec OpenOffice, l'enregistrer avec
les noms des élèves comme nom de fichier (important).
— Copier et coller le texte qui se trouve sous la ligne.
— pour chaque question, il faut retirer les réponses fausses
(une seule erreur entraîne la perte du point).
— dix minutes avant la fin de l'heure, le travail est à envoyer
sur place.
Conseils
Enregistrer régulièrement le travail.
Pour la recherche, se partager la lecture de l'écran.
La mise en page doit être lisible (ne perdez pas de temps à
reformater le texte)
N'oubliez pas la synthèse !
Voici les sites à consulter
http://www.dreyfus.culture.fr/fr/
http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/dreyfus/dreyfus-chrono.asp
(Voir livre page
148) En 1894, un capitaine de l’armée est
accusé d’avoir livré des renseignements militaires à l’Allemagne
et condamné à la déportation à l’île du Diable (Guyane). Il
s’agit d’Alfred Dreyfus, né en 1859 dans une famille juive de
Mulhouse. À partir de 1898, l’histoire du capitaine devient une
affaire politique sur fond d’antisémitisme, divisant la société
en deux camps et fragilisant la République.
- Antisémitisme:
- (Voir livre page 149) sentiment de haine contre les juifs,
qui peut dégénérer en actions violentes contre eux.
3• La séparation de l'Église et de l'État
Lecture de document:
— Aristide Briand défend le projet de loi devant les députés
- Séance du 4 mars 1905
— L'opposition au projet de loi - Discours d’Henri-Constant
Grousseau, député du Nord, professeur à l’Université
catholique de Lille pendant la séance du 27 mars 1905
Question 4 et 5 page 151
(Voir livre
page 148) La loi de séparation des Églises et
de l'État de décembre 1905 souhaite avant tout réduire
l’influence de l’Église catholique dans la société, et faire de
la religion une affaire privée. Les catholiques, en partie
ralliés à la République, considèrent cette loi comme une
agression. Au printemps 1906, le Pape les engage à résister aux
« inventaires » des biens des églises qui doivent être
administrés désormais par des associations.
4• Un
parlementaire lorrain de la IIIe République : Jules Ferry
Lire 5 page 152, faire la biographie de l'auteur
Jules Ferry (1832-1893). Né à Saint-Dié
(Vosges), fils d'avocat. Jules Ferry fut lui-même avocat: il
défendit sous l'Empire des républicains poursuivis pour délit de
presse. A partir de 1865. il se consacre surtout au journalisme
au « Temps ». Élu député républicain de Paris en 1869. il vote
les crédits militaires en 1870. Il fait partie du Gouvernement
de la Défense nationale, puis il est nommé Maire de Paris. On le
surnomme alors « Ferry famine ». Élu député des Vosges en
février 1871. il est nommé ministre plénipotentiaire en Grèce où
il demeure jusqu'à [a Chute de Thiers. De nouveau député en
1877. son grand rôle commence en 1879. De février 1879 à mars
1885, il fut presque sans interruption ministre de l'instruction
publique et Président du Conseil à deux reprises (septembre
1880-novembre 1881 et février 1883-mars 1885). Il fut
l'organisateur de l'enseignement primaire publique, gratuit et
lai'c et l'initiateur de l'expansion coloniale française. Sous
son premier ministère furent votées les lois instituant la
liberté de la presse et la liberté de réunion ( 1 881 ). Sous
son second, la loi sur les syndicats et les conseils municipaux
(1884).
1789_1970, l'Époque Contemporaine, Collection Isaac, Hachette,
1971.
Jules Ferry (né en 1832 et mort en 1893) est avocat : un
notable et un orateur. C'est un républicain qui défend la
liberté de presse. Il est élu député, c'est le maire de Paris
pendant le siège de 1870. Devenu ministre de l'Instruction
publique, il propose la loi sur l'école primaire laïque,
gratuite et obligatoire de 1881-1882. Il est ensuite président
du conseil (équivalent du 1er ministre) alors que les lois sur
la liberté de presse et de réunion sont votées. Il soutient
l'expansion coloniale (en Afrique et en Indochine).
•
Texte de Jules
Ferry (n'est pas dans le manuel)
«ce qui manque le plus à notre grande industrie, ce sont les
débouchés. Il n'y a rien de plus sérieux; or ce programme est
intimement lié à la politique coloniale. Il faut chercher des
débouchés.
Il y a un second point que je dois aborder: c'est le côté
humanitaire et civilisateur de la question. Les races
supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures. Ce
devoir a souvent été méconnu dans l'histoire des siècles passés.
Mais de nos jours, je soutiens que les nations européennes
s'acquittent avec grandeur et honnêteté de ce devoir supérieur.
Il faut aussi appeler un instant votre attention: à savoir
qu'une marine comme la nôtre ne peut pas se passer sur la
surface des mers, d'abris solides, de défense, de centre de
ravitaillements.
Rayonner sans agir, sans se mêler des affaires du monde, croyez
le bien, c'est abdiquer, c'est descendre du premier rang au
troisième puis au quatrième.
Est-ce que les gouvernements français laisseront d'autres que
nous s'établir en Tunisie? d'autres que nous faire la police à
l'embouchure du Fleuve Rouge?
D'après Jules Ferry, Discours au parlement en 1885 paru au
journal officiel
5• Le choix d'un régime politique stable
Page 146 : La liberté guidant le peuple
Comment Delacroix
représente-t-il la liberté ?
Quels personnages figurent le
peuple ?
Où se trouvent sur le
tableau les ennemis du peuple et de la liberté ?
Quelle image le tableau de
Delacroix nous donne-t-il des affrontements politiques pendant
le siècle ?
Comparez les figures
représentées par Delacroix et Daumier : pourquoi peut-on en
conclure que Daumier est républicain ?
Synthèse : À partir des symboles présents sur les documents et de la
frise, retrouvez les différents régimes qui se sont succédés
de 1815 à 1914.
(Voir livre page 146)
Après les bouleversements nés de la période révolutionnaire
et de l’industrialisation, la société française change
profondément. Les Français sont à la recherche d’un régime
politique qui puisse assurer l’ordre et la stabilité, tout en
accompagnant et en favorisant les évolutions sociales. La
succession des coups d’État, des révolutions, des guerres et
des crises politiques montre la difficulté du problème.
— La Restauration (de la monarchie) est imposée par le congrès
de Vienne (1814) -> le retour à l'Ancien Régime n'est pas
possible.
— La monarchie de juillet est trop conservatrice, elle est
renversée par les républicains et libéraux.
— La deuxième République est remise en cause par le mouvement
ouvrier.
— Le Second Empire est un régime trop autoritaire (censure, exil
des opposants, corruption)
— La Commune est une tentative de république sociale : elle est
durement réprimée.
— La IIIe République commence avec une majorité royaliste, elle
va favoriser le patriotisme avec l'école publique, le service
militaire, la colonisation.
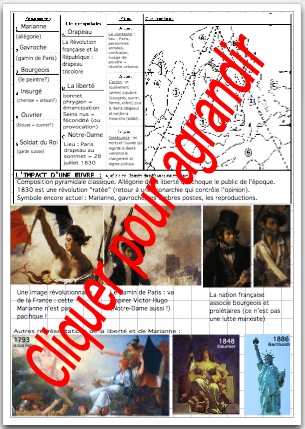
- c
- p
La Liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix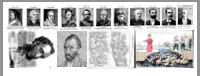


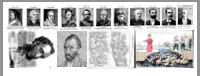


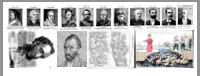 Frise
chronologique : Les régimes politiques de la France de
1810 à 1910.
Frise
chronologique : Les régimes politiques de la France de
1810 à 1910.